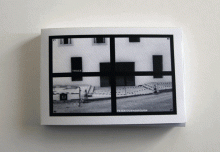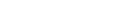Exposition Richard Meier Détour
jusqu’au 15 septembre à la Casa Carrère, Mairie de Bages, 22 av. Jean-Jaurès, 66670 Bages, France. Durant les expositions, tous les jours de 16 h à 19 h. Tél. : 04 68 21 71 25.

Vernissage vendredi 12 juillet à 18 h 30.
Exposition ouverte jusqu’au 15 septembre 2013, de 16 h à 19 h, du mardi au dimanche.
Casa Carrère 9 av. de la Méditerranée 66670 Bages.
Interview Arts Hebdo Médias – Septembre 2013
Si Richard Meier n’a pas mis d’« s » à Détour, c’est que malgré une interruption de près de vingt ans, il n’y a pas eu de rupture dans son travail. Cette exposition actuellement présentée à Bages, dans les Pyrénées-Orientales, raconte l’histoire d’un peintre devenu éditeur sans jamais avoir renoncé à être artiste.
A l’entrée de la Casa Carrère, des journaux démesurés accueillent les visiteurs. Depuis juillet, ils sont nombreux à être passés par Bages pour découvrir Détour de Richard Meier. Si ce nom ne vous est pas étranger et que vous l’associez spontanément au domaine de l’édition, c’est tout à fait normal ! Editeur, l’homme est avant tout artiste. Ancien professeur des Beaux-Arts de Metz, il est installé non loin de Perpignan depuis bientôt dix ans travaillant sans relâche à la réalisation d’ouvrages rares tantôt inspirés par l’art des autres, tantôt répondant à un impératif personnel. « La pratique de mes carnets me suffisait amplement. Avec eux et les livres, j’allais à l’essentiel », explique-t-il comme pour s’excuser de s’être laissé entraîner dans l’aventure d’une nouvelle exposition. Dix-neuf ans après celle de Rotterdam, qui devait clore son travail de peintre. Sous l’amicale et néanmoins répétée sollicitation d’un groupe d’amis, Richard Meier a cédé et s’est remis à la peinture. Neuf toiles de grand format, réalisées à la spatule, sont accompagnées de carnets et autres expérimentations plastiques déroulant le fil d’un travail artistique de plus de vingt ans. « Je me suis aperçu de tout ce qui s’est passé durant ces dernières années. Mon travail de peintre est nourri désormais de littérature et de poésie. Il contient moins de formalisme mais plus de sens. » Un détour qui suscite une bonne poignée de questions. Entretien avec un intellectuel sensible et passionné.
ArtsHebdo|Médias. – Que s’est-il passé il y a dix-neuf ans ?
Richard Meier. – A cette époque, j’avais commencé à éditer et je sentais que ce serait difficile de continuer la peinture. Pendant un an, j’ai préparé ce que je pensais être ma dernière exposition. Ce fut une des plus intéressantes. Elle rendit compte de la distance que j’avais pris avec la toile. Je travaillais déjà tellement le papier que la mémoire de la feuille s’était imposée : je peignais désormais sur du blanc. Avant ma peinture était bruyante, comme j’aimais à le dire. Pleine de couleurs et de figures qui s’accumulaient. J’avais déjà commencé mes carnets, un travail poursuivi jusqu’à aujourd’hui.
Quel est le statut de ces carnets ?
Ils traduisent ma démarche d’artiste et prouvent qu’elle n’a jamais cessé. Certains d’entre eux ont un lien étroit avec des livres que j’ai édités. Ils expliquent comment tel ou tel ouvrage naît et se déploie. Plus généralement, j’y consigne idées, formes… Grâce à eux, j’ai pu faire évoluer le difficile rapport que j’entretenais avec l’écriture – ma première langue n’est pas le français. Au début, il y avait surtout beaucoup de commentaires et progressivement s’est installé quelque chose de plus ambitieux, de l’ordre de la poésie. J’aime jouer avec les mots, qui sombrent dans des arcanes complexes, dans les entrelacs de ma pensée. J’utilise beaucoup le principe d’écholalie, de répétition. Ces carnets ont vocation à être lus, mais je n’en ai jamais édité.
Dites-nous en plus sur eux.
Les premiers datent de la fin des années 1970 et désormais j’en ai environ soixante-quinze. Je les appelle les icebergs, car ils ne montrent qu’une part de moi-même, ce qui veut bien émerger. La découverte des carnets de Paul Valéry a influencé cette pratique. La première fois que j’ai vu ces derniers, j’ai pris une claque monumentale. Les self pensées de l’écrivain m’ont subjugué. Tenter de comprendre comment une pensée se télescope à une autre, comment se fait la greffe, est passionnant. Avec l’expérience, il y a quelque chose qui se construit de l’ordre du moi, de l’intimité, du temps. Tout entre en soi et sort sans que l’on sache vraiment comment. J’aime solliciter la mémoire, et activer les liens qui se créent d’une page à l’autre. Parfois il faut revenir en arrière pour être certain de ce qui a été vu. Nous avons conscience de parcourir un espace qui peut grâce aux figures qui y surgissent s’élargir encore et encore.
Comment peut-on préméditer l’arrêt de sa peinture ?
Avec le recul, je constate que mon rapport à la peinture a toujours été particulier. Aux Beaux-Arts, par exemple, j’ai choisi d’enseigner l’édition alors que j’étais peintre. Si j’avais dû toute la journée expliquer et trouver des choses à dire aux élèves dans ce domaine, je crois que je n’aurais pas peint du tout. Par ailleurs, je me rends compte maintenant que mon admiration pour les écrivains et les poètes devance celle que j’ai pour les peintres. La peinture m’a vite dépassé. Alors que je débutais, elle fut abandonnée par nombre d’artistes et cette mise à l’écart m’a beaucoup troublé. Quand on est jeune, tous les bruits de fond vous concernent ! Au bout du compte, ce n’est pas très important. Les tendances peuvent s’inverser et les pratiques revenir. D’ailleurs, les nouvelles générations ont des idées beaucoup plus simples sur la peinture que les miennes.
Parlez-nous de cette exposition qui devait être la dernière ?
D’abord, comme un pied de nez à l’époque, j’ai voulu exposer avec ma sœur qui est peintre naïve. L’autre point à signaler est probablement l’utilisation que j’ai faite du plâtre. J’en appliquais sur la toile facilement entre vingt et trente couches très fines. Une façon pour moi de convoquer l’idée du palimpseste, de me placer dans une forme de continuité et aussi de relier ma pratique à ma vie. Etudiant, j’ai travaillé dans le bâtiment. Peint beaucoup de murs pour gagner un peu d’argent. Ce qui m’a permis de constater que le plâtre restituait très bien la couleur du temps. Le matin, il est un peu bleu, le soir, un peu rose. J’appréciais énormément cette qualité car elle évoquait pour moi, d’une façon cocasse peut-être, les dragées de Verdun, celles de mon enfance, qui changent de couleur quand on les met dans la bouche. Un phénomène qui se produit également si l’on observe les eaux d’un fleuve à divers moments de la journée… Bref, la série réalisée pour l’exposition de Rotterdam s’est intitulée Meuse, « Maas » en néerlandais. J’avais travaillé à un parcours stylisé du cours d’eau. Certains éléments étaient dessinés au crayon. Je m’intéresse encore beaucoup aujourd’hui au graff, aux représentations, à la cartographie, à la simplification des éléments picturaux.
La peinture n’était-elle donc pas accrochée à votre estomac ?
Absolument, mais le problème, c’est qu’elle est passée de l’estomac à la tête ! Tout a basculé vers l’univers mental même si je faisais attention à ce que l’émotion ne disparaisse pas de la toile. Pendant longtemps, j’ai peint de façon improvisée. Il me fallait seulement quelques heures pour réaliser un tableau. Aujourd’hui, je suis interrogatif devant ce que j’ai pu faire comme ça. Ça me paraît excessif. Progressivement le cerveau a pris le pas sur l’instinct. Le silence a eu de plus en plus d’importance. Il permet une sorte de recul, une façon de distinguer les choses. Non dans le sens de la valeur mais plutôt dans celui du discernement. Une manière de ne pas encombrer le monde. C’est en Hollande que le vide, essentiel aujourd’hui, a commencé à retenir mon attention.
Pratiquement, comment vous êtes-vous remis à peindre ?
Je suis parti de mes carnets et j’ai ressenti le besoin de mettre mon ancienne peinture derrière moi. Ce que j’ai fait physiquement en installant une de mes anciennes toiles dans mon dos ! J’ai ensuite interprété mes carnets avec des moyens mécaniques où le pinceau n’intervenait plus. Quand je voulais faire une courbe, je posais des bandes de scotch. Les vibrations venaient du pouce comme si je faisais des dessins au fusain. La peinture était appliquée en dernier à la spatule et les morceaux de scotch retirés. J’ai mis en place une méthode.
Qu’entendez-vous par là ?
Avec le travail d’édition, ma peinture est devenue matérielle. Il y avait quelque chose à exécuter alors qu’avant mon geste était « très cézanien ». La peinture se distribuait dans l’espace. Je n’avais pas l’impression de fabriquer un objet. Avec l’idée de « factory » introduite dans l’art, on parle de pièce plus souvent que d’œuvre – les mots sont importants, les définitions jamais innocentes. Et ce terme contenait une notion de méthode. J’en ai donc choisi une, tout en continuant néanmoins à solliciter l’instinct pour ne pas provoquer d’enfermement. Je tente toujours d’être attentif à ce qui se produit et, de cette observation, je tire un système pour aller plus loin. Son but est d’être amplifié jusqu’à ce qu’il se dépasse.
Que dire de votre nouvelle peinture ?
La peinture que je fais aujourd’hui est peut-être un peu plus forte, plus engagée physiquement que ce que j’ai fait pour l’expo de Rotterdam. Quand je m’y suis remis après autant de temps, j’ai eu des surprises. Certaines choses s’étaient effacées, d’autres ne demandaient qu’à resurgir. Mais si je ne savais pas ce que j’allais exécuter, je savais absolument ce que je ne voulais pas faire. Je n’ai d’ailleurs pas hésité à détruire un tableau que j’aimais bien mais qui, à mes yeux, utilisait de mes petites ficelles… J’avais peur de retomber dans mes travers. J’ai dû faire le vide absolu et laisser venir les choses. J’ai alors découvert que ce que je faisais était en phase par rapport à mon dernier travail d’éditeur.
L’exposition à la Casa Carrère montre certaines de vos anciennes toiles. Pourquoi ?
Parce que, d’une part, je ne disposais pas d’assez de temps pour produire de plus nombreuses peintures et, d’autre part, parce que je savais que nombre de personnes étaient très intriguées par mon parcours. Elles voulaient faire comprendre le rapport entre mes éditions et ma peinture. L’exposition va dans ce sens. J’y montre les dernières travaux d’avant Meuse, comme les journaux peints, et des toiles qui n’avaient jamais été exposées. Désormais, ces dernières ne seront plus accrochées chez moi. Je n’ai plus besoin de les voir. Je dois passer à autre chose, casser le lien. Vivre avec ce que l’on a fait, c’est comme se regarder sans cesse dans un miroir. Jusqu’à présent, mes peintures accompagnaient les œuvres acquises auprès des autres artistes. C’était une manière d’être ensemble. Maintenant qu’ils ont découvert mon travail, il n’est plus nécessaire de l’accrocher à la maison !
Allez-vous poursuivre ?
Je ne sais pas mais ça m’a plu, malgré le stress du départ ! Je pense que si j’avais peint davantage mes livres auraient avancé d’autant. Alors… Dans mes carnets, il y a une sorte de narration de ma vie qui se développe et qui ne se voit plus dans les livres que je fais aujourd’hui. L’importance donnée à l’espace, au vide, à la scansion, à la respiration. Les artistes qui m’intéressent aujourd’hui ne sont plus ceux qui m’intéressaient au début de mes éditions. Tout a évolué. Si je peins, je ferai nettement moins de livres. C’est certain. Mais peindre, c’est produire quelque chose de nouveau. Il faut y croire, se battre, se donner des coups de pied au derrière, arriver à dégager de la fraîcheur. Et je ne sais pas encore si j’ai envie de tout cela.
La peinture ne vient-elle pas toujours de quelque part, d’une connaissance stratifiée ?
Effectivement, l’histoire revient sous certaines formes. En ce moment, par exemple, j’ai un intérêt renouvelé pour l’art optique. Je ne l’utilise pas à proprement parler, mais il est présent dans ma volonté de faire vibrer la couleur. J’aime que l’œil soit pincé, qu’il ressente du plaisir physique à regarder. Si ma peinture pouvait devenir un peu plus aiguë, j’en serais très content. J’aime aussi beaucoup les choses contradictoires, celles qui ne se terminent pas. Dans mes carnets, je joue avec les mots. J’ai rempli des pages entières avec les trois premières lettres de certains d’entre eux. Il m’arrive aussi parfois de dessiner leur représentation toujours de manière elliptique. Je crée une sorte de symphonie, utilise la droite et la gauche comme une balance. Lourde d’un côté, légère de l’autre.
Qu’allez-vous faire demain ?
Certainement beaucoup de dessin. J’ai un stock de papier 20 gr. Au moins 500 feuilles ! Très fin, il sert habituellement à emballer des moteurs…